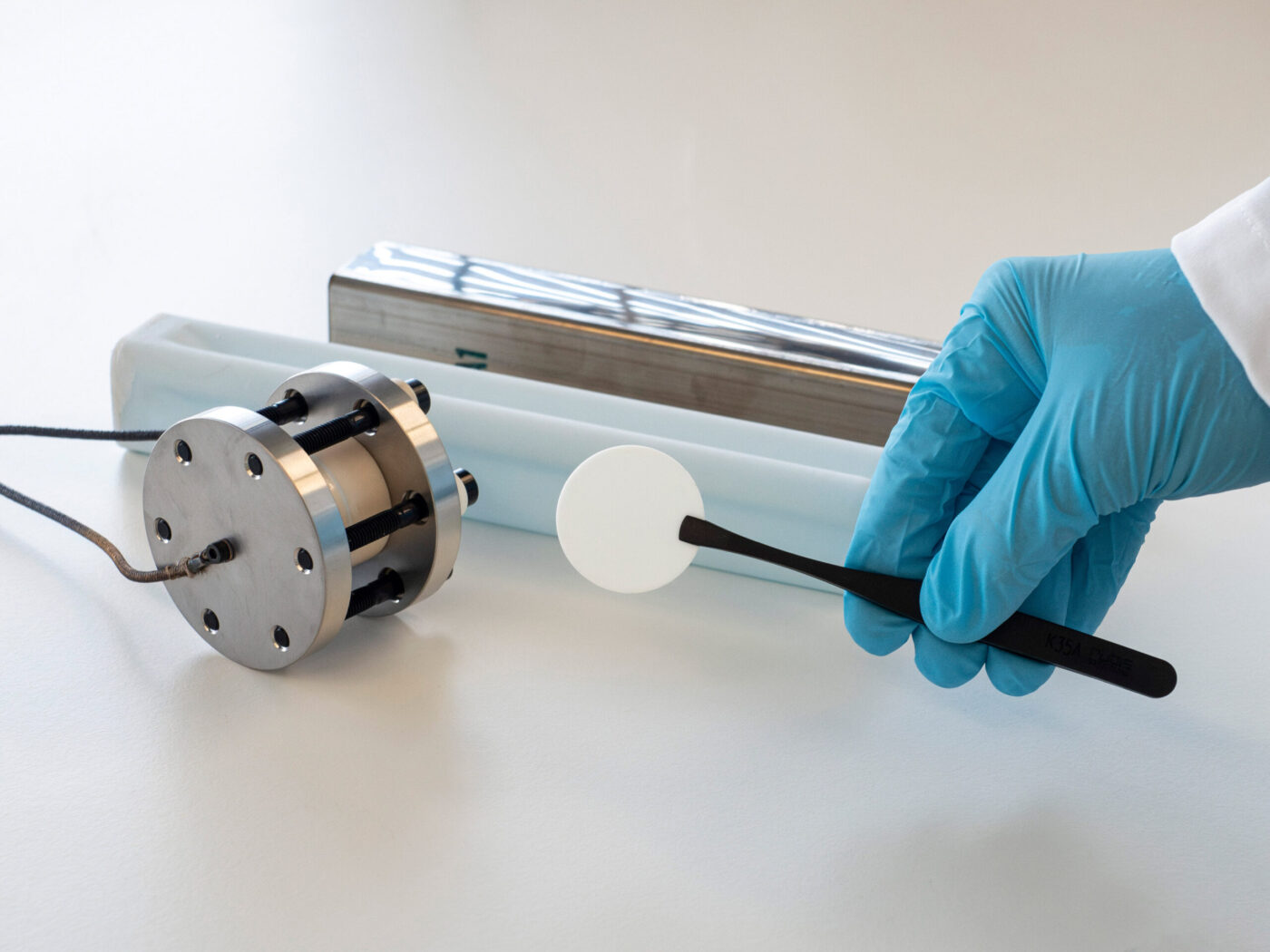Sécurité et protection des enfants
La manière d’éduquer les enfants évolue avec le temps, et ce, à plusieurs égards. Selon certains auteurs (p.ex., Furedi, 2008), un des principaux changements contemporains concerne une plus grande propension des parents à éviter toute forme de danger ou de risque pour leur progéniture.

Cette attitude prévoyante est largement alimentée par les médias qui diffusent de nombreux messages alarmistes. Dans ce contexte, les parents d’aujourd’hui deviendraient plus protecteurs, voire paranoïaques, en ce qui concerne l’éducation de leurs enfants. Dans le cadre d’un projet financé par le Fonds national suisse de la recherche (FNS), une équipe de chercheurs du FAmily and DevelOpment research center (FADO) de l’Université de Lausanne a interrogé 512 adolescents et 467 parents du canton de Vaud afin de mieux comprendre la parentalité contemporaine et de vérifier les hypothèses concernant son évolution. A travers plusieurs questionnaires, les chercheurs ont investigué les différents facteurs qui expliquent pourquoi certains parents aujourd’hui deviennent surprotecteurs.
Le risque de vouloir trop bien faire
La surprotection parentale désigne la tendance d’un parent à protéger son enfant de manière disproportionnée par rapport au niveau du développemental de ce dernier. Un parent surprotecteur peut, par exemple, interdire à son enfant de jouer dehors, le prévenir des moindres dangers et réagir fortement s’il lui arrive un désagrément. Bien que ces comportements reflètent un fort investissement et une bonne intention du parent, ils nuisent aux besoins développementaux de l’enfant et, par conséquent, à son bien-être et son épanouissement psychosocial. En effet, lorsqu’un parent surprotège son enfant, il entrave à son autonomie et son sentiment de se sentir capable de faire face à des difficultés et des situations complexes. En outre, il empêche son besoin de nouer des relations fortes avec ses pairs. Ces besoins étant entravés, plusieurs études indiquent qu’en comparaison avec les autres enfants, celui qui est surprotégé présente davantage de symptômes somatiques (par ex., maux de ventre), anxieux, dépressifs et comportementaux. Ces observations ont été confirmées dans notre projet FNS. Néanmoins, d’après les données du projet, les phénomènes de surprotection restent relativement rares dans les familles vaudoises. Seuls 28,7% des adolescents indiquent que leur mère est plutôt surprotectrice, et 11% avaient une impression analogue pour leur père. Ces résultats nous ont conduits à nous questionner sur les origines de la surprotection parentale.
Eduquer dans une société considérée comme dangereuse
Les raisons qui amènent un parent à surprotéger son enfant sont diverses. Tout d’abord, certaines caractéristiques propres au parent peuvent expliquer ce phénomène. Par exemple, un parent particulièrement anxieux a plus tendance à être surprotecteur. Sa prévoyance et son souci de bien faire le poussent à envisager toutes les contrariétés que son enfant peut rencontrer et à tout mettre en œuvre pour que ce dernier les évite.
En parallèle, certaines caractéristiques propres à l’enfant peuvent également susciter des tendances surprotectrices chez le parent. Notamment, lorsque l’enfant est timide ou anxieux, le parent compense ce trait de caractère en prenant des initiatives à sa place. Plusieurs études indiquent que la relation entre la surprotection parentale et le tempérament de l’enfant est bidirectionnelle : la personnalité de l’enfant suscite de l’attention particulière de la part des parents, et la réponse excessive des parents renforce sa dépendance. En d’autres termes, un cercle vicieux s’installe au sein d’une famille. En plus de ces éléments propres au parent et à l’enfant, plusieurs facteurs macro-contextuels sont également à l’origine de la surprotection parentale.
L’aversion du risque pour les parents
Différentes caractéristiques de la société occidentale contemporaine expliquent la surprotection parentale. Premièrement, bien que les risques liés à la criminalité, les accidents routiers, ou encore les guerres sont généralement moins présents qu’auparavant, les médias se sont développés et relèvent davantage les dangers qu’encourent les individus (Pinker, 2018). Par ailleurs, les enfants sont perçus comme particulièrement vulnérables et trop immatures pour avoir conscience des dangers qu’ils encourent. Dans une logique de safetyism, les parents se sentent responsables de ce qui peut arriver à leur enfant et considérent davantage le risque comme une menace qu’il faut absolument éviter (Furedi, 2008). Dans l’étude menée par le FADO, 24,7% des mères et 22,3% des pères ont tendance à percevoir le monde extérieur comme dangereux, en répondant positivement à des arguments tels que: «Il existe de nombreuses personnes dangereuses aujourd’hui qui vont attaquer quelqu’un sans aucune raison, par pure méchanceté» ou «Aujourd’hui, les enfants font face à un avenir imprévisible. On peut passer d’une minute à l’autre de la prospérité à la pauvreté». Les données indiquent également que cette perception du danger est fortement liée au niveau de protection que les parents prodiguent à leur enfant: plus les parents trouvent le monde dangereux, plus ils ont tendance à être surprotecteurs.
Trop de pression entrave l’éducation
En plus de la perception du danger omniprésent dans l’environnement de l’enfant, l’insécurité économique grandissante contribue à la perception pessimiste du monde extérieur et amène les parents à adopter des comportements surprotecteurs. En effet, une étude suggère que les parents vivant dans un pays qui comporte des inégalités économiques plus prononcées ont plus tendance à être surprotecteurs (Doepke & Zilibotti, 2019). Ceci est particulièrement le cas aux Etats-Unis, par exemple, où les parents poussent leurs enfants à travailler sans relâche afin qu’ils puissent accéder aux universités et obtenir une bourse. A cela s’ajoutent les normes éducatives exigeantes demandant aux parents d’aspirer à la perfection, en investissant énormément d’énergie, de temps et d’argent pour que l’enfant se développe de manière optimale. En effet, les parents sont également considérés comme responsables de l’avenir de leur enfant. Dans notre projet, la majorité des mères et des pères ont confirmé percevoir cette pression sociale, en répondant globalement positivement à des arguments tels que: «La société me dit qu’un bon parent veille à protéger son enfant», ou «La société me fait comprendre qu’un bon parent s’assure de préserver la santé et la sécurité de son enfant». Comme illustré dans le graphique ci-dessous, trois sources de pressions semblent particulièrement importantes: la pression sociétale, la pression médiatique (p.ex. livres, télévision, réseaux sociaux) et la pression des autres parents. La pression d’être un parent parfait est surtout ressentie par les mères, ce qui peut expliquer pourquoi la surprotection est davantage observée chez elles plutôt qu’auprès des pères.

Un contexte anxiogène
Les parents d’aujourd’hui éduquent leurs enfants dans un contexte particulier, marqué par une certaine insécurité concernant leur avenir. En plus des normes exigeantes auxquelles ils sont soumis afin que ces derniers puissent s’épanouir et se développer de manière optimale, ils se sentent souvent responsables d’agir en fonction des nombreuses informations alarmistes véhiculées par les médias. Ainsi, il semble important de prendre en compte les facteurs macro-contextuels pour comprendre l’émergence de la surprotection parentale. En voulant trop bien faire, certains parents adoptent des comportements surprotecteurs, au détriment d’un développement harmonieux de leur enfant.
Dr. Stijn Van Petegem, 1er assistant UNIL, responsable de recherche. stijn.vanpetegem@unil.ch
Gaëlle Venard, collaboratrice de recherche FNS. gaelle.venard@unil.ch